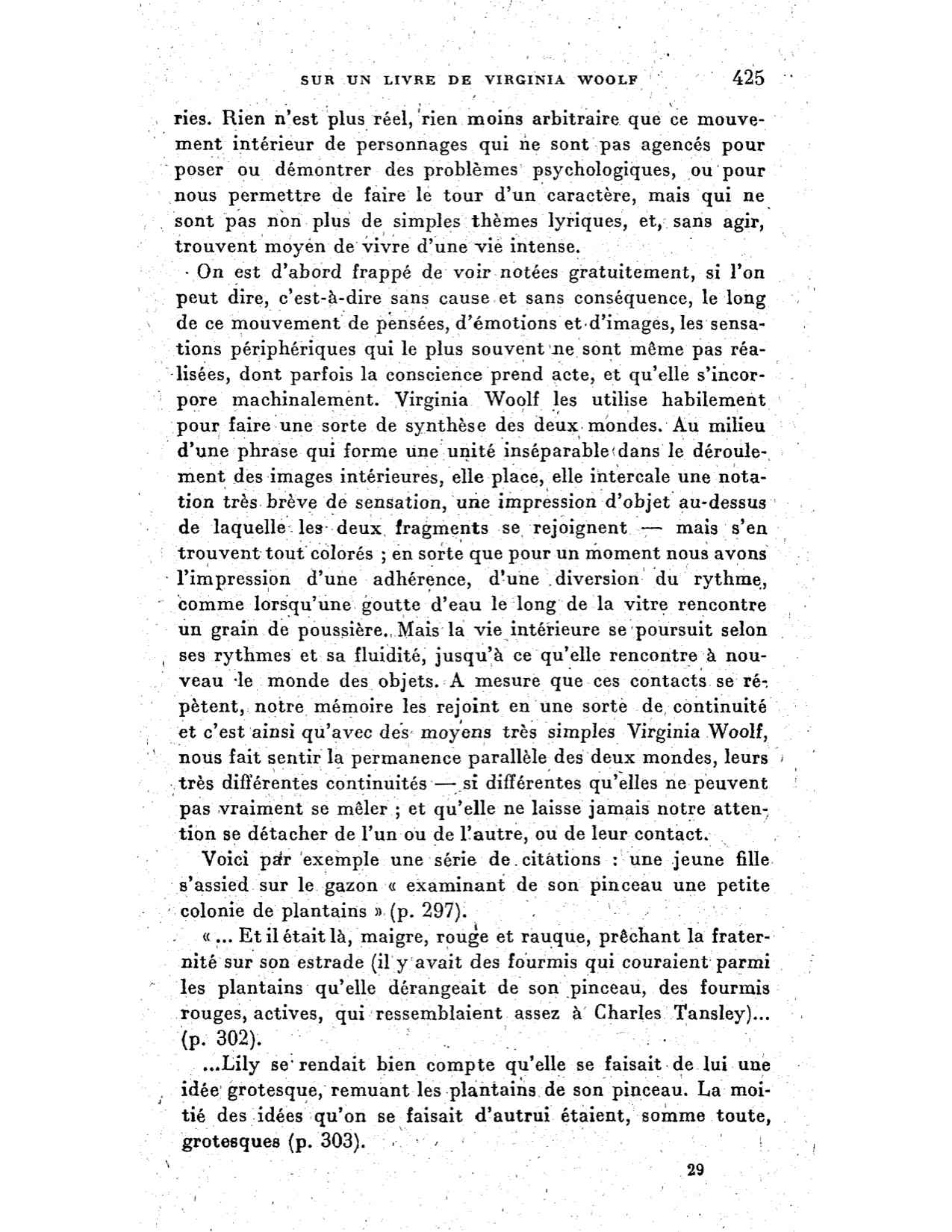
Rien n’est plus réel, rien moins arbitraire que ce mouvement
intérieur de personnages qui ne sont pas agencés pour
poser ou démontrer des problèmes psychologiques, ou pour
nous permettre de faire le tour d’un caractère, mais qui ne
sont pas non plus de simples thèmes lyriques, et, sans agir,
trouvent moyen de vivre d’une vie intense.
On est d’abord frappé de voir notées gratuitement, si l’on
peut dire, c’est-à -dire sans cause et sans conséquence, le long
de ce mouvement de pensées, d’émotions et d’images, les sensations
périphériques qui le plus souvent ne sont même pas réa-
lisées, dont parfois la conscience prend acte, et qu’elle s’incorpore
machinalement. Virginia Woolf les utilise habilement
pour faire une sorte de synthèse des deux mondes. Au milieu
d’une phrase qui forme une unité inséparable dans le déroulement
des images intérieures, elle place, elle intercale une notation
très brève de sensation, une impression d’objet au-dessus
de laquelle les deux fragments se rejoignent—mais s’en
trouvent tout colorés; en sorte que pour un moment nous avons
l’impression d’une adhérence, d’une diversion du rythme,
comme lorsqu’une goutte d’eau le long de la vitre rencontre
un grain de poussière. Mais la vie intérieure se poursuit selon
ses rythmes et sa fluidité, jusqu’à ce qu’elle rencontre à nouveau
le monde des objets. A mesure que ces contacts se répètent,
notre mémoire les rejoint en une sorte de continuité
et c’est ainsi qu’avec des moyens très simples Virginia Woolf,
nous fait sentir la permanence parallèle des deux mondes, leurs
très différentes continuités—si différentes qu’elles ne peuvent
pas vraiment se mêler; et qu’elle ne laisse jamais notre attention
se détacher de l’un ou de l’autre, ou de leur contact.
Voici par exemple une série de citations: une jeune fille
s’assied sur le gazon <<examinant de son pinceau une petite
colonie de plantains >> (p. 297).
<<… Et il était là , maigre, rouge et rauque, prêchant la fraternité
sur son estrade (il y avait des fourmis qui couraient parmi
les plantains qu’elle dérangeait de son pinceau, des fourmis
rouges, actives, qui ressemblaient assez à Charles Tansley)…
(p. 302).
…Lily se rendait bien compte qu’elle se faisait de lui une
idée grotesque, remuant les plantains de son pinceau. La moitié
des idées qu’on se faisait d’autrui étaient, somme toute,
grotesques. (p.303).






